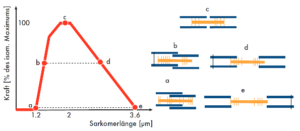10 conseils alimentaires pour ta perte de poids
Ces 10 conseils alimentaires t'aideront à atteindre ton poids idéal. Mange au maximum 1 à 2 fois par jour de petites portions d'aliments riches en glucides comme le pain, les pâtes, les pommes de terre.